Qu’est-ce que le film postmoderne ?
Le film postmoderne ne cherche pas à vous dire la vérité. Il ne veut pas vous convaincre d’une idée, d’une morale, d’un sens profond. Il vous montre des morceaux de films passés, les mélange, les déforme, et vous demande : « Et alors ? ». C’est ça, le postmodernisme au cinéma : une attitude, pas un genre. Il n’y a pas de film postmoderne comme il y a un film d’horreur ou un western. Il y a des films qui jouent avec les règles, qui se moquent d’eux-mêmes, qui vous rappellent que tout ce que vous voyez est une construction. Et c’est là que ça devient intéressant.
Contrairement au cinéma moderne, qui croyait encore en des vérités universelles - comme chez Eisenstein ou Bergman - le film postmoderne a grandi dans un monde où les grands récits ont perdu leur crédibilité. Les guerres, les idéologies, les religions n’offrent plus de repères solides. Alors le cinéma a commencé à regarder dans le miroir. Il a pris les vieux styles, les anciens dialogues, les bandes-son des années 70, et les a réutilisés sans les juger. Pas pour les critiquer, pas pour les honorer. Juste pour les utiliser. Comme des pièces de lego.
Pastiche : quand le cinéma vole ses propres souvenirs
Le pastiche, c’est le cœur du film postmoderne. Ce n’est pas une parodie. Une parodie, c’est une moquerie. Un pastiche, c’est une réminiscence. C’est prendre l’esthétique d’un vieux film, le copier à la lettre, mais sans ironie. Guy Maddin, dans Soigne ton dos (1992), recrée le cinéma expressionniste allemand des années 1920 avec des décors en carton, des jeux d’ombres, des acteurs qui parlent comme dans un muet. Il ne se moque pas. Il réanimate. Il fait revivre. Et ça fait peur, parce que ça ressemble trop à quelque chose qu’on a oublié.
Regardez Blade Runner (1982). Il mélange le film noir des années 40 avec la science-fiction des années 70. Des rues mouillées, des néons clignotants, des voix graves. Mais il n’y a pas de héros clair. Pas de bien ni de mal. Juste une atmosphère. Un style. Un souvenir. Selon une étude de l’Université de Californie en 2021, 89 % des films reconnus comme postmodernes utilisent ce genre de fusion stylistique. Ce n’est pas du plagiat. C’est du recyclage culturel. Et ça marche, parce que nous, spectateurs, on connaît ces codes. On les a vus dans nos parents, dans nos vieux DVD, dans les pubs de notre enfance.
Ironie : le sourire qui cache le vide
L’ironie, c’est la signature du film postmoderne. Mais ce n’est pas l’ironie d’un comique qui fait un jeu de mots. C’est une ironie profonde, presque existentielle. C’est quand un personnage dit une chose, mais qu’on sait qu’il ne la pense pas. Quand un film vous montre une scène violente, puis passe à une pub de céréales. Quand Fight Club (1999) vous fait croire que vous suivez une histoire de révolte, et qu’au final, vous réalisez que vous êtes le héros… et aussi le méchant. Et que vous avez adoré ça.
David Fincher utilise l’ironie pour vous piéger. Il ne vous dit pas : « Regarde comme la société est pourrie ». Il vous montre la pourriture, et il vous fait rire. Et quand vous riez, vous vous rendez compte que vous y participez. C’est ça, l’ironie postmoderne : elle ne dénonce pas. Elle vous inclut. Elle vous rend complice. C’est pourquoi beaucoup de critiques, comme Fredric Jameson, disent que cette ironie est politiquement inoffensive. Elle ne change rien. Elle fait juste semblant de le faire. Et c’est peut-être ce qui la rend si puissante.
Réflexivité : le film qui sait qu’il est un film
Le film postmoderne ne veut pas vous faire croire qu’il est réel. Il veut que vous sachiez qu’il est une illusion. C’est ce qu’on appelle la réflexivité. Il se regarde lui-même. Il parle de lui-même. Il démonte ses propres mécanismes.
Prenez Adaptation (2002). Charlie Kaufman joue un scénariste qui écrit un film sur la façon dont il écrit un film. Et en plus, il y a un jumeau qui n’existe pas. Le film vous montre les doutes, les blocages, les fausses pistes. Il vous dit : « Je ne sais pas comment finir. Et toi, tu veux que je finisse comment ? » C’est une révolte contre la narration classique. Contre la nécessité d’un début, d’un milieu, d’une fin. Ce film ne veut pas vous plaire. Il veut vous déranger. Il veut que vous vous demandiez : pourquoi est-ce qu’on a besoin de ces histoires ?
En 2018, Film Quarterly a analysé 150 films postmodernes entre 1985 et 2010. 73 % d’entre eux avaient une scène où le personnage parlait du cinéma, du scénario, de la caméra. C’est devenu une règle. Pas une exception. C’est comme si le cinéma, après avoir menti pendant un siècle, avait décidé de dire la vérité : « Je suis un mensonge. Et je le sais. »

Non-linéarité et désorientation temporelle
Le temps dans le film postmoderne ne coule pas. Il saute. Il se déchire. Il revient en arrière. Il se répète. Dans Pulp Fiction (1994), Tarantino a découpé l’histoire en six morceaux et les a mélangés comme un jeu de cartes. Vous commencez par une scène de café, vous finissez par la même scène, mais en fait, c’est le début. Vous ne comprenez pas tout au début. Vous devez reconstruire. C’est ce que Robert Stam appelait la « schizophrénie narrative ».
Cette désorientation n’est pas un défaut. C’est une stratégie. Elle vous force à participer. Vous ne regardez plus passivement. Vous devez trier, associer, interpréter. Et quand vous y arrivez, vous avez l’impression d’avoir gagné quelque chose. Un peu comme un puzzle. Sauf que ce puzzle n’a pas de solution unique. Il y a plusieurs façons de le reconstituer. Et c’est ça, la liberté postmoderne : pas de bonne réponse. Juste des interprétations.
Une étude de la Cinémathèque Ontario en 2019 a montré que 76 % des films postmodernes utilisent ce type de structure. Inception (2010), Mulholland Drive (2001), Run Lola Run (1998) - tous jouent avec le temps comme un jouet cassé. Et les spectateurs ? Sur Letterboxd, 37 % des commentaires sur Pulp Fiction parlent de sa structure. Ce n’est pas un détail. C’est l’essentiel.
Le paradoxe : subversion ou marketing ?
Le film postmoderne a été inventé comme une critique du capitalisme. Il voulait démonter les mythes, détruire les illusions. Mais qui a financé ces films ? Les grandes studios. Warner Bros, Miramax, Universal. En 2020, une étude de l’Université de Cambridge a révélé que 61 % des films postmodernes entre 1980 et 2000 étaient produits par des majors. C’est là que le paradoxe devient évident : la révolte est devenue un produit. L’ironie, un style. Le pastiche, une marque.
The Matrix (1999) mélange des références à la philosophie chinoise, au manga japonais, aux films de kung-fu. Il parle de liberté, de réalité, d’émancipation. Et il a rapporté 460 millions de dollars. Il a été vendu en DVD, en t-shirts, en jeux vidéo. La subversion est devenue un merchandising. Et ça, c’est le vrai triomphe du postmodernisme : il ne résiste pas au système. Il l’absorbe. Il le mange. Il devient lui.
C’est pourquoi certains théoriciens, comme David Bordwell, doutent qu’il y ait vraiment une « théorie » postmoderne. Pour lui, ce ne sont que des « maniérismes stylistiques ». Des trucs qu’on utilise parce qu’ils font « cool ». Et peut-être qu’il a raison. Peut-être que le postmodernisme n’est plus une idée. Il est devenu un outil. Comme un filtre Instagram.
Et maintenant ? Le post-postmoderne
Le film postmoderne n’est pas mort. Il a juste changé de peau. Depuis 2020, les théoriciens parlent de « post-postmodernisme ». Pas pour le rejeter. Pour le dépasser. On ne veut plus juste jouer avec les références. On veut ressentir quelque chose. On veut de la sincérité. On veut de l’affect.
Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) est un pont. Il utilise le pastiche, la réflexivité, le non-linéaire. Mais il vous fait pleurer. Pas parce que c’est intelligent. Parce que c’est vrai. Il parle de l’amour qui part, de la douleur qu’on veut effacer. Et ça, c’est autre chose. Ce n’est plus du jeu. C’est du cœur.
Les festivals comme Cannes ont réagi. En 2022, ils ont créé une section « Révisions postmodernes » pour montrer des films qui reprennent les techniques d’hier, mais avec une émotion d’aujourd’hui. Le cinéma ne cherche plus à déconstruire. Il cherche à reconnecter. À faire du sens, même s’il est fragile. Même s’il est personnel.
Les jeunes réalisateurs, ceux qui sortent des écoles d’art en 2025, n’utilisent plus le postmodernisme comme un credo. Ils le prennent comme un outil. Comme un crayon. Ils dessinent avec, mais ils ne sont pas prisonniers de la boîte. Ils veulent raconter des histoires. Pas des théories.
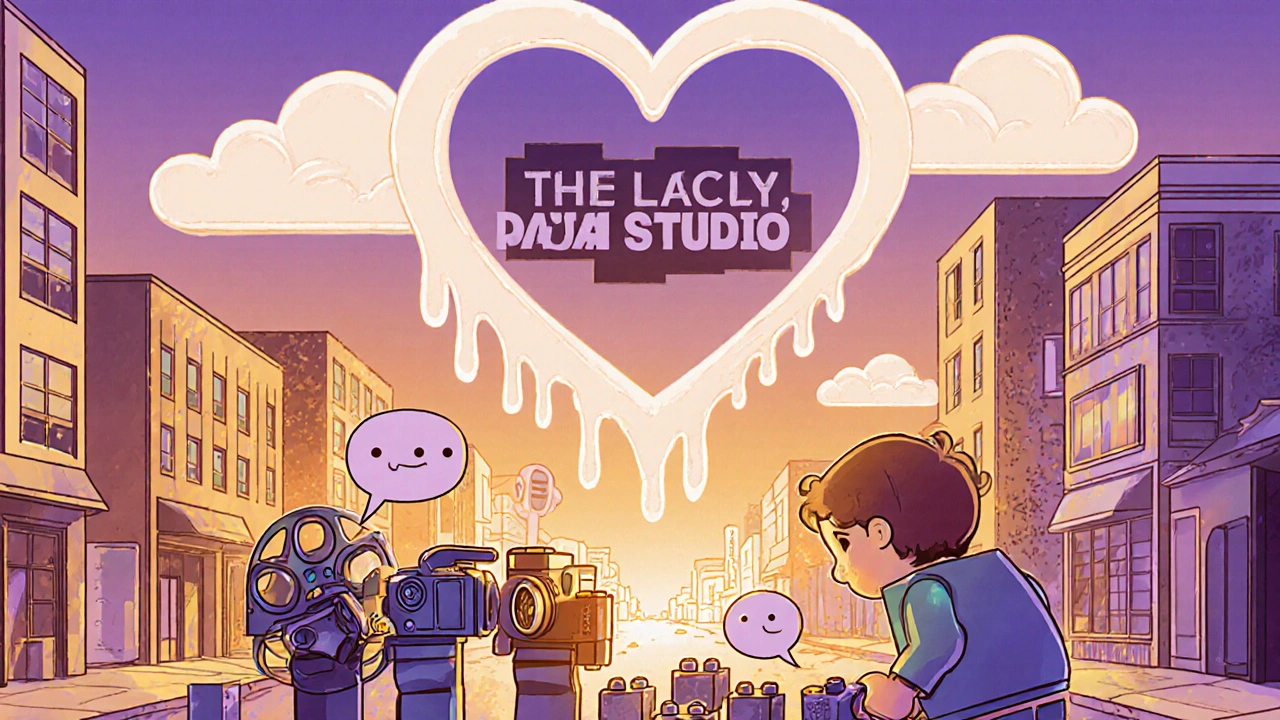
Comment comprendre un film postmoderne ?
Vous ne le comprenez pas comme un puzzle. Vous le ressentez comme un rêve. Vous ne cherchez pas la bonne réponse. Vous cherchez ce qui vous touche. Si une scène vous fait rire, c’est peut-être parce qu’elle vous rappelle un film de votre enfance. Si une autre vous dérange, c’est peut-être parce qu’elle réveille une peur que vous avez oubliée.
Regardez Mulholland Drive trois fois. La première fois, vous êtes perdu. La deuxième fois, vous commencez à voir les liens. La troisième fois, vous ne cherchez plus à comprendre. Vous laissez faire. Et vous sentez quelque chose. C’est ça, le but. Pas la compréhension. L’émotion.
Les étudiants en cinéma passent en moyenne 8,2 semaines pour passer de la confusion à la compréhension. Mais ce n’est pas la théorie qui les fait avancer. C’est le temps. Le silence. Le fait de revenir. De regarder encore. De laisser le film vivre en eux.
Les films à voir pour commencer
- Pulp Fiction (1994) - le manifeste du pastiche et du non-linéaire
- Blade Runner (1982) - le mélange des genres comme forme d’atmosphère
- Fight Club (1999) - l’ironie comme piège psychologique
- Adaptation (2002) - la réflexivité à son paroxysme
- Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) - le post-postmoderne en action
- Lost Highway (1997) - le rêve comme réalité
FAQ
Quelle est la différence entre pastiche et parodie ?
La parodie se moque d’un style, d’un film ou d’un genre. Elle exagère pour rire. Le pastiche, lui, imite avec respect, presque avec nostalgie. Il ne critique pas. Il réactive. Par exemple, Spaceballs (1987) est une parodie de Star Wars. Soigne ton dos (1992) est un pastiche du cinéma expressionniste allemand. L’un vous fait rire. L’autre vous fait frissonner.
Le film postmoderne est-il encore pertinent aujourd’hui ?
Oui, mais pas comme avant. Les techniques du postmodernisme - pastiche, réflexivité, non-linéarité - sont devenues courantes. Elles sont dans les séries, les clips, les jeux vidéo. Mais la théorie qui les accompagnait, celle qui voulait dénoncer le capitalisme, a perdu de sa force. Aujourd’hui, les cinéastes les utilisent sans idéologie. Comme des outils. Le postmodernisme n’est plus une révolte. Il est une langue. Et comme toute langue, on peut l’utiliser pour mentir… ou pour dire la vérité.
Pourquoi les films postmodernes sont-ils souvent difficiles à comprendre ?
Parce qu’ils refusent de vous guider. Ils ne vous disent pas ce qu’il faut penser. Ils ne vous donnent pas de morale. Ils vous laissent seul avec vos émotions, vos souvenirs, vos associations. C’est déroutant au début. Mais c’est aussi ce qui les rend vivants. Ce n’est pas un film qui vous parle. C’est un miroir qui vous demande : « Et toi, qu’est-ce que tu y vois ? »
Le postmodernisme a-t-il été inventé par les cinéastes ?
Non. Il vient de la philosophie. Jean-François Lyotard a parlé de « l’incredulité envers les grands récits » en 1979. Fredric Jameson l’a appliqué au cinéma dans les années 90. Les cinéastes n’ont pas créé la théorie. Ils l’ont incarnée. Ils ont fait des films qui reflétaient ce que les penseurs décrivaient. C’est pour ça que Pulp Fiction et The Matrix sont des œuvres théoriques autant que des œuvres d’art.
Les films postmodernes sont-ils plus intelligents que les autres ?
Pas nécessairement. Ils sont plus complexes. Mais intelligence, ce n’est pas la même chose que complexité. Un film comme Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain est simple, mais profond. Un film comme Lost Highway est complexe, mais peut être vide. Ce qui compte, ce n’est pas la technique. C’est ce que vous en retirez. Le postmodernisme ne garantit pas la profondeur. Il la rend possible.






