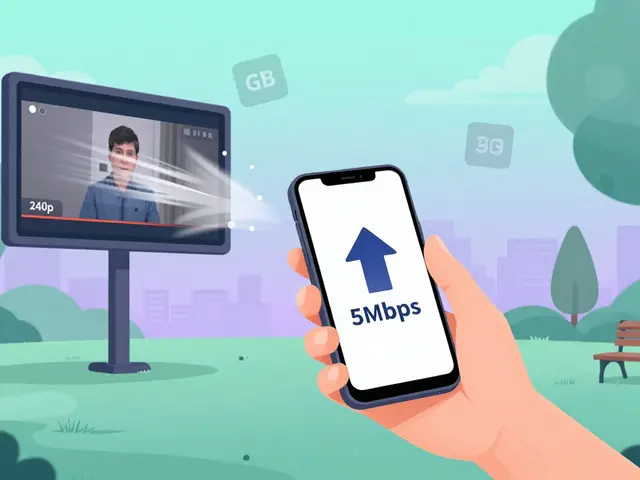Quand on voit Poor Things pour la première fois, on ne sait pas si on regarde un film d’horreur, une comédie absurde ou une fresque historique déformée par le rêve. Et c’est exactement ce que voulait Yorgos Lanthimos. Ce n’est pas un film qui explique ses règles. Il les impose. Et la conception de production - les décors, les costumes, les objets, les couleurs - est la clé de cette expérience. Pas seulement un décor. Une machine à déranger.
Un monde qui n’a jamais existé, mais qu’on reconnaît
Le Londres de Poor Things n’est pas celui des livres d’histoire. Ce n’est pas non plus un futur dystopique. C’est un passé qui a mal tourné. Les bâtiments ont des façades victoriennes, mais les fenêtres sont trop grandes, les escaliers trop raides, les plafonds trop hauts. Les rues sont propres, mais les gens ont des regards vides ou trop vifs. Les voitures à vapeur ronflent comme des dragons en ferraille. Tout semble familier - jusqu’au moment où un homme marche sur les mains en portant un poulet vivant.
La production a travaillé avec l’artiste de production Sharon Gal et la directrice artistique Fiona Crombie pour créer un univers où la logique industrielle du XIXe siècle a fusionné avec les fantasmes d’un enfant. Les couleurs ne suivent pas la réalité : les murs sont teints dans des tons de vert bouteille, de rose pâle, de jaune citron. Les costumes d’Emma Stone, qui joue Bella Baxter, changent de style à chaque scène - parfois victorien, parfois futuriste, parfois comme un costume de carnaval fait à la main. Rien n’est cohérent. Et c’est précisément ce qui rend le monde crédible.
L’humour noir, écrit dans les détails
L’humour noir de Poor Things ne vient pas des dialogues. Il vient des objets. Un médecin fait une autopsie sur un cadavre en buvant du thé. Une femme se réveille dans un lit avec un bébé en porcelaine à la place du sien. Un chien parle, mais personne n’y fait attention. Le rire ne vient pas de l’absurde. Il vient du fait que l’absurde est traité comme normal.
Les décors sont remplis de petites scènes qui n’ont rien à voir avec l’intrigue principale, mais qui racontent tout. Dans un salon, une femme brode un portrait de sa propre tête en train de fondre. Dans une bibliothèque, les livres ont des titres comme Comment remplacer son cerveau avec un poulet. Un enfant joue avec un jouet qui ressemble à un cerveau humain, mais qui crie quand on le serre. Ces détails ne sont pas des gags. Ce sont des affirmations. Le film dit : La raison est une fiction. La société est un masque. Et la liberté ? Elle ressemble à une femme qui court nue dans les rues de Londres en riant comme une folle.
Le néo-victorien : pas une reconstitution, une déformation
Beaucoup pensent que Poor Things est un film victorien. Ce n’est pas vrai. C’est un film qui utilise les formes victoriennes pour en faire une parodie. Les chapeaux sont trop grands, les corsets sont trop serrés, les crinolines sont trop larges. Les maisons ont des escaliers en colimaçon, mais les marches sont en verre. Les lampes à gaz sont remplacées par des ampoules électriques, mais elles clignotent comme des cœurs battants.
La production a utilisé des matériaux modernes pour imiter des objets anciens. Les meubles sont en bois, mais les joints sont en plastique transparent. Les tissus sont en soie, mais les motifs sont des graphiques de données médicales du XIXe siècle. C’est un monde qui a essayé de progresser, mais qui a gardé ses superstitions. Un monde où la science est une religion, et où les femmes sont à la fois des sujets d’étude et des révoltées.

Le rôle des couleurs : une palette émotionnelle
Les couleurs dans Poor Things ne sont pas décoratives. Elles sont émotionnelles. Quand Bella est dans l’atelier de son créateur, tout est gris, blanc, et vert sale - les teintes de l’expérimentation. Quand elle découvre la ville, les couleurs explosent : rose, jaune, violet. Quand elle est en voyage avec Mark, le monde devient terne, bruns et ocre - comme si la liberté avait perdu sa saveur.
La production a utilisé des filtres de lumière naturelle pour accentuer ces changements. Les scènes intérieures sont éclairées par des lampes à gaz artificielles, mais les extérieurs sont tournés à l’heure dorée, avec des ombres longues et des teintes saturées. Ce n’est pas du réalisme. C’est de la psychologie visuelle. Chaque couleur correspond à un état d’esprit de Bella. Et chaque objet dans le cadre - un livre, une tasse, un chapeau - est choisi pour renforcer ce sentiment.
Les objets comme personnages
Dans Poor Things, les objets ont plus de personnalité que certains personnages. Le piano qui joue tout seul. Le chien qui parle avec un accent écossais. Le livre qui s’ouvre tout seul pour révéler des dessins anatomiques. Ces objets ne sont pas magiques. Ils sont simplement réels dans ce monde. Et c’est ce qui les rend effrayants.
La production a demandé aux artisans de fabriquer des objets qui semblent avoir été utilisés pendant des décennies, même s’ils venaient d’être faits. Les tasses ont des traces de doigts. Les livres ont des pages froissées. Les portes grincent comme si elles avaient été ouvertes mille fois. Ces détails ne sont pas des efforts pour le réalisme. Ce sont des signes que ce monde fonctionne, même si personne ne comprend comment.
Le contraste entre l’intérieur et l’extérieur
Les intérieurs de Poor Things sont étouffants. Les murs sont trop proches. Les meubles sont trop lourds. Les lumières sont trop douces. Les chambres ressemblent à des musées de la folie. Mais à l’extérieur, tout est ouvert. Les rues sont larges. Les ponts sont hauts. Le ciel est immense. C’est comme si Bella, en sortant de l’atelier, sortait de l’enfer pour entrer dans un paradis qui ne sait pas qu’il est paradis.
Ce contraste n’est pas un hasard. Il est conçu pour montrer que la liberté n’est pas un lieu. C’est un état. Et le design de production le dit sans un mot. Les murs intérieurs sont couverts de livres de médecine. Les fenêtres extérieures sont ouvertes, mais les volets sont fermés. La société veut contrôler. Bella veut voir. Et le décor nous montre ce combat sans que personne ne parle.

La musique des objets
Le son n’est pas seulement une bande originale. C’est une extension du design. Les portes claquent comme des coups de fusil. Les escaliers grincent comme des os. Les voitures à vapeur crachent des sons de baleines blessées. Les cloches des églises sonnent faux. Même les rires des personnages sont enregistrés avec un effet de réverbération qui les rend artificiels.
La production a collaboré avec le compositeur Jerskin Fendrix pour créer une bande sonore qui ressemble à un instrument de musique mécanique qui a été mal réparé. Les notes sont justes, mais le tempo est décalé. C’est exactement comme les décors : tout est en ordre… mais pas comme il le devrait.
Un film qui refuse d’être compris
Poor Things ne cherche pas à être aimé. Il cherche à être ressenti. La conception de production n’est pas là pour plaire. Elle est là pour troubler. Pour faire douter. Pour obliger le spectateur à se demander : Est-ce que je suis le seul à voir ça comme ça ?
C’est un film qui ne donne pas de réponses. Il ne cherche pas à expliquer la folie de Bella. Il ne juge pas la société. Il ne condamne pas la science. Il la montre. Et il le fait avec des meubles en verre, des chapeaux trop grands, et des chiens qui parlent. Parce que parfois, la vérité n’a pas besoin de mots. Elle a besoin de décors.
Un héritage qui ne se répète pas
On a vu des films avec des décors victoriens. On a vu des comédies noires. On a vu des films sur les femmes qui se libèrent. Mais jamais tout ensemble. Jamais avec cette précision. Jamais avec cette audace. Poor Things ne ressemble à rien d’autre. Et c’est ce qui le rend inoubliable.
La production a créé un monde qui n’existe nulle part - sauf dans notre imagination. Et c’est peut-être la plus grande réussite du film : il nous fait croire, un instant, que ce monde pourrait exister. Et que peut-être, nous y vivons déjà.